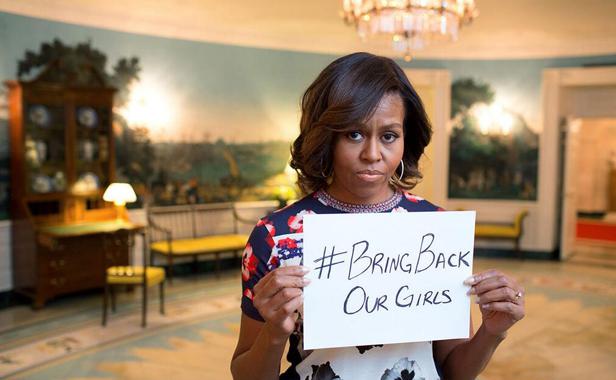Tous les écrivains sont l’Ecrivain
Note de lecture de « La Couleur de l’écrivain » de Sami Tchak
Sami Tchak représente une singularité dans la jeune génération des écrivains africains francophones nés autour des années soixante. Ce natif du Togo, installé en France depuis 1986, s’est créé son « étrangeté » en inscrivant le décor d’une grande partie de son œuvre pas en Afrique ou en France – comme l’ont fait presque tous les classiques de la littérature africaine francophone, comme le font aujourd’hui la plupart de ses pairs, mais en Amérique latine, notamment au Mexique, à Cuba, en Colombie…
Le grand prix littéraire d’Afrique noire 2004 suscite de l’admiration par l’originalité de son œuvre, mais, tout comme les autres écrivains de sa génération vivant en Occident, les écrivains de la « migritude » comme les a baptisés l’émérite universitaire Jacques Chevrier, il suscite aussi des interrogations, beaucoup d’interrogations sur ses choix littéraires, ses relations avec son pays d’adoption et avec sa langue d’écriture le français, ses rapports avec le lectorat de son Togo natal où il ne retourne désormais que très rarement, sa conception de l’engagement de l’écrivain…
« La Couleur de l’écrivain », son nouveau livre, qui vient de paraître aux éditions La Cheminante, en France, répond à toutes ces questions. Composé de trois parties : « Peau et conscience », « Comédie littéraire », « Eloge de la Sarienne », le livre, à travers de courtes réflexions, des récits de voyages, des extraits d’auteurs, des nouvelles… expose, d’une part, les incapacités, les peurs, les attentes de ce condensé de frustrations qu’est aujourd’hui l’écrivain africain francophone, et analyse, d’autre part, des problématiques plus globales liées à la profession d’écrivain, à la littérature…
Il est question de ces créateurs obligés d’écrire en français – une langue qui n’est pas leur langue natale, mais celle qu’ils ont apprise à l’école – obligés, ces écrivains africains francophones, de publier dans des maisons d’édition françaises pour espérer être lus, l’activité littéraire dans leurs pays d’origine étant presque morte, obligés de subir les remontrances des Franco-français qui les accusent presque d’écrire en français et non dans leurs langues natales, obligés de subir l’humiliation de l’indifférence dans leurs pays d’origine, leurs livres n’y étant pas lus parce que pas facilement disponibles dans les librairies… Tout un engrenage de frustrations que l’auteur résume, en guise de réponse à une interlocutrice avec qui il converse tout au long du livre : « Madame… Nous le savons, nous connaissons le problème : un public naturel, une nation, une langue constituent les bases de l’épanouissement de toute littérature, et nous n’en avons pas. »
Il est également question de l’engagement de l’écrivain africain qu’on renvoie toujours vers celui qui est devenu le roi de l’engagement dans la littérature africaine d’expression française : Mongo Béti. « On a l’impression que les écrivains africains de la nouvelle génération sont un peu plus individualistes, plus préoccupés par la question de leur visibilité que par le destin de leur pays et de leur continent… » demande l’interlocutrice à l’auteur. Sami Tchak, après une longue analyse sur la question, lui répond avec l’un des plus beaux passages du livre : « Tous les débats ont leur utilité peut-être, mais les écrivains ne doivent pas oublier que la littérature, engagée ou pas, a ses propres exigences, que ce n’est pas forcément avec un cœur gros comme une montagne qu’on bâtit une œuvre puissante. Les bonnes intentions ne sont pas un obstacle à la bonne littérature, mais elles n’accouchent pas forcément du Voyage au bout de la nuit. »
Les réflexions sont entrecoupées d’extraits d’illustres auteurs aussi variés que Erasme, Dostoïevski, Julien Gracq (chacun d’eux exprimant sa vision particulière de la littérature et de l’écrivain)… de nouvelles et de récits de voyages ressortant des thèmes qui reviennent généralement dans les romans et essais de l’auteur : le racisme, la pauvreté, le crime, la violence, le sexe… On y retrouve la très originale nouvelle : « Vous avez l’heure ? » qui a valu en 2005 à l’auteur le Prix William Sassiné.
Un hommage à Ananda Dévi, célèbre auteure mauricienne, clôture le livre. Sami Tchak, par de courtes évasions littéraires, dissèque l’œuvre de l’auteure de Solstices, Soupir, La vie de Joséphin le fou… à travers ses personnages. «Son monde est celui de la beauté douloureuse, des douceurs amères, de l’amour surchargé de haine, des corps maudits qui se cherchent eux-mêmes tout en cherchant les autres pour des unions fatales. »
En plus de vingt-cinq ans de carrière, depuis la parution de son premier roman, « Femme infidèle », en 1988, Sami Tchak a construit, à travers une douzaine de romans et d’essais, une œuvre d’une irréfutable puissance. Vingt-cinq ans d’expériences qu’il partage, gracieusement, page par page, dans « La Couleur de l’écrivain », avec en sourdine ce refrain : Qu’ils viennent d’Afrique, d’Europe, d’Amérique, d’Asie… malgré les difficultés et les déboires liés à leurs origines, tous les écrivains, les vrais, ne font qu’une littérature : La Littérature.
Sami Tchak, « La Couleur de l’écrivain », La Cheminante, 2014, 224 pages, 20 euros